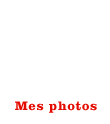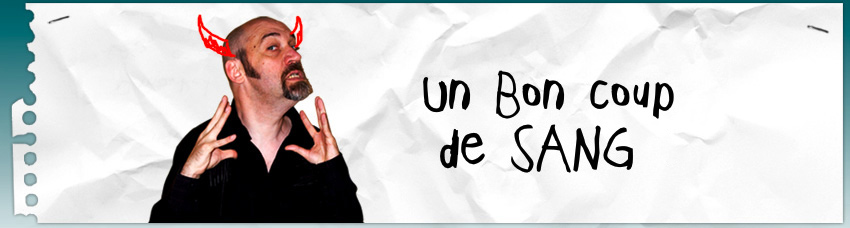
Pendant une quinzaine d’années, Dominique Watrin a publié mensuellement sur ce site une chronique « coup de poing » sur une sujet majeur (ou mineur) inspiré par l’actualité chaude (et quelquefois simultanément glaciale) du mois. Ces textes parfois repris sur les planches pour des cours de seul-en-scène, parfois même étudiés dans les écoles, mêlaient faits de société, vérité pas bonne à dire et mauvaise foi à peine dissimulée, le tout sous une forme courte, choc, mais incroyablement digeste. À lire ou à relire… pour le plaisir ou le déplaisir !
Les victimes d�??Albert Camus
Je ne veux pas plomber l’enthousiasme de tous ses fans qui célèbrent en ce moment le centième anniversaire de la naissance d’Albert Camus à coups de lancements de cotillons et de serpentins, mais je le dis publiquement : ce type n’est pas aussi respectable qu’on veut le faire croire. Je peux en témoigner, car je fais partie des milliers de ses victimes qui ont dû lire, sous une contrainte qui a laissé de marbre Amnesty International et l’association des parents de mon école, le livre « La Peste » d’Albert Camus.
« La Peste », ça a été LE livre de torture de mes études secondaires. Chaque année, au premier cours, le prof de cinquième distribuait à chacun un titre de livre à lire pour la fin de l’année. Et, dès que les élèves avaient acheté LEUR livre, le rituel était identique pour tous. Pas se jeter dessus pour le dévorer ! Le jeter dans un coin de sa chambre, après avoir effectué la manoeuvre la plus importante : vérifier le nombre de pages. Après ma condamnation à Albert Camus, j’ai découvert avec effroi la longueur de ma peine : 400 pages. Qu’est-ce que j’ai détesté mon voisin de classe, Alain, qui avait hérité de « Vipère au poing » d’Hervé Bazin, 240 pages, et surtout le sale type assis derrière moi, Pascal, qui avait reçu « Thérèse Desqueyroux » de François Mauriac, 192 pages, la moitié du mien. Bon, pour être honnête, qu’est-ce que je me suis aussi moqué de mon copain Luc qui avait tiré « Germinal » d’Émile Zola, 608 pages !
Ne me félicitez pas, mais je l’ai lu jusqu’à la page 56, mon livre ; qui peut en dire autant ? D’accord, la fille de l’autre classe de cinquième qui avait reçu le même livre a fait mieux : la page 107 ! Mais elle, c’était une fille et, pendant que moi, j’écoutais mes disques de Pink Floyd, elle, elle écoutait ceux de Maxime Leforestier ; elle était habituée à pleurer sur des histoires tristes, sur le frère qu’elle n’avait jamais eu et sur la baraque pourrie adossée à la colline où on vient à pied et où on ne frappe pas.
Je le concède, quand le prof m’a interrogé à l’examen oral, j’ai dû un peu broder. J’ai dit que la peste, c’était triste, que c’était une maladie, que je n’étais pas docteur mais que ça avait l’air plus grave qu’une sinusite et qu’un rat, ça a l’air gentil comme ça, mais il faut s’en méfier. Bref, l’essentiel. Bon, pour la cote, j’ai dû un peu préparer mes parents, mais le pire restait à suivre : me débarrasser du livre. Je l’ai exposé plus de vingt fois en brocante et je l’ai toujours !
Voilà ! Je voudrais dédier cette chronique à tous mes (innombrables) frères de souffrances et particulièrement ceux dont je n’ai pas parlé : les victimes de Joseph Kessel et de son Lion, 256 pages.